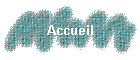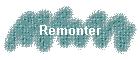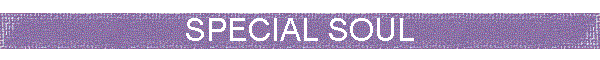SA PART
DE BONHEUR
Quand un
artiste meurt jeune et de façon aussi tragique, il n'est pas rare que notre
société sans cesse en quête d'idoles le déifie sur‑le‑champ et prononce le
terme de génie en guise d'oraison funèbre. Pour Otis Redding, ce mot ne fut
jamais prononcé et sans doute est‑ce normal si l'on reste sur un plan
strictement musical, le génie d'Otis étant ailleurs.
Fondamentalement différent de celui d'un Charlie Parker ou d'un John
Coltrane, le génie d'Otis Redding était celui de la vie. La vie telle qu'elle
est, la vie qui bouillonnait en lui et emportait tout dans de grands éclats
de rire ou de chansons, la vie, heureuse, qui le transfigurait et dans
laquelle il mordait à belles dents. En cela, Otis était bien souvent
déconcertant, comme un grand gosse insouciant qui pose des yeux remplis de
candeur sur le monde et qui trouve que tout est bien. Égoïsme ou simplicité
extrême, je préfère opter pour la seconde hypothèse et appliquer à notre
homme la fameuse phrase de Voltaire : « Il avait l'esprit simple et droit, et
c'est pour cela, je crois, qu'on l'appelait Candide
».
Peut‑être Otis
est‑il mort à vingt‑six ans parce qu'il avait, durant ce temps trop bref,
plus vécu que bien des gens pour qui la vie est une pénitence qu'il faut bien
accomplir jusqu'au bout. Peut‑être que le bonheur nous est compté, mesuré, et
que, quand nous en avons eu notre part, il faut nous en aller. Otis a eu sa
part, et n'est‑ce pas une forme de génie de refuser d'être un gagne‑petit du
bonheur, de vivre une vie aussi belle et brillante que la trace d'une étoile
filante dans un ciel de nuit ? Sans doute.
LE
FUSIL OU LA CHANSON
Nous avons dit
qu'Otis Redding n'était pas un génie musical, c'est vrai. Disons aussi qu'à
notre avis, les génies de la musique, de toutes les musiques, se comptent sur
les doigts des deux mains. Otis Redding fut un grand musicien au sens plein
du terme, et son moindre mérite ne sera pas d'avoir relancé, rénové, rajeuni
une musique d'une richesse incomparable et qui se mourrait faute d'un grand
talent : le rhythm and blues. Élevé dans la lumière à la fois tendre et
brûlante du Deep South, Otis a grandi là où la musique est souvent le seul
refuge contre le monde extérieur où Jim Crow se manifeste à chaque minute. Et
je me demande s'il faut plus admirer Otis Redding d'avoir été un homme
heureux plutôt que de ne pas avoir été un homme aigri. Quelle force de
caractère ou quelle naïveté incurable faut‑il donc pour vivre une vie de Noir
dans le Sud des États Unis sans se révolter, j'avoue que cela reste pour moi
un mystère.
Par chance (?),
il y a la musique, le blues, remède universel du peuple noir américain. «Le
Noir n'a jamais rien possédé et n'attend rien ; aussi, quand il a le blues,
il s'en sort avec le sourire et sans rancoeur... Le Blanc, quand il lui
arrive un coup dur, ça le rend mauvais, il se monte tout seul et devient
méchant... le Noir, lui, peut aussi bien tout chasser avec une blague et une
chanson mélancolique (pas trop mélancolique tout de même)... Il n'a peut‑être
pas de mots ronflants ou de théories pour exprimer ce qu'il pense. N'importe.
Il sait. Il raconte tout ça dans sa musique. C'est là que vous trouverez
l'explication, pour peu que vous sachiez la chercher »
(M. Mezzrow et B. Wolfe «La
rage de vivre»).
Simplification
? Mystification? Acceptation de l'injustice ? Sans doute, surtout maintenant
que bon nombre de Noirs qui savent ont compris qu'il valait mieux prendre un
fusil plutôt que de chanter, n'empêche que pour beaucoup la chanson est
encore un assez bon moyen d'évasion, même si ce n'est pas un outil aussi
efficace qu'un fusil pour changer une société. Otis Redding était
probablement de ceux‑là, qu'il soit remercié pour les quelques minutes de
bonheur et d'oubli qu'il a procurées et procure encore à quelques millions de
ses frères.
UNE
PORTE ENTROUVERTE, UN SOUFFLE...
Il a donc
grandi dans ce Sud poussiéreux où le blues se mélange au jazz, au gospel et à
la variété, et sans doute a‑t‑il été influencé par tout cela à la fois. C'est
le blues, pourtant, qui tient une place prépondérante dans son oeuvre, un
blues transformé, à la fois plus simple et plus complexe que celui d'un
Lightnin' Hopkins ou d'un T. Bone Walker. Plus simple parce que collant moins
à la vie et qu'une chanson d'Otis Redding, sur le papier, n'est guère
différente de milliers d'autres (c'est lui, en la chantant, qui la rendra
différente) tandis que les paroles du vrai blues sont des tranches de vie
propres à celui qui les a composées et qu'il nous livre toutes chaudes. Plus
complexe parce qu'au fil de ses productions, Otis a constamment cherché à
enrichir la trame harmonique de ses mélodies et de leur accompagnement, comme
s'il voulait à tout prix s'évader du carcan des sempiternelles douze mesures
tout en gardant l'esprit du blues intact. C'est là, sans doute, que se trouve
l'essentiel de son oeuvre (un bien grand mot dont il rirait), dans ce travail
d'élargissement, de dépoussiérage du rhythm and blues jusqu'alors voué à se
répéter sans cesse et à se plagier lui‑même, voies idéales pour aboutir à la
sclérose puis à la mort. Otis a entrouvert une porte, peut‑être ne
saurons‑nous jamais sur quoi elle donnait car personne, actuellement, ne
semble en mesure de poursuivre l'oeuvre ébauchée. Néanmoins, une bouffée de
l'air du dehors aura soufflé sur le rhythm and blues et lui aura, pour un
temps, redonné quelques couleurs.
UN PEU
DE TENDRESSE
Trois morceaux
dans l'oeuvre d'Otis me paraissent propres à une étude succincte de son
cheminement musical et peuvent, peut‑être nous permettre d'imaginer vers
quelle voie il s'orientait au moment de sa disparition.
«Satisfaction»,
étape principale de la période «dure» (on aurait aussi bien pu choisir «Shake»
ou «I can't turn you loose»), nous montre un Otis Redding chauffeur à tout
prix, grand bonhomme arpentant la scène de long en large, hachant la mélodie
sur un fond de cuivres en fusion et de riffs aussi simples qu'efficaces. Peu
à dire de cette période sinon que, déjà, Otis avait dépassé tout le monde sur
le plan du swing.
«Try a little
tenderness», joyau baroque de toute son oeuvre, c'est comme le titre
l'indique la période tendre, la voix sauvage se fait douce, voilée,
émouvante, pour distiller une mélancolie retenue pendant que l'accompagnement
se fait moins sommaire, moins mécanique. La fin du morceau, retour au feu,
montre bien que cette période n'est que transitoire et que le coeur d'Otis
balance encore entre ce qu'il a déjà fait et ce qu'il voudrait faire. Et
pourtant, I'équilibre était parfait entre la tendresse et la violence, le
compositeur et l'interprète avaient atteint là un sommet qu'ils ne
retrouveront plus par la suite.
Ce qu'Otis
voulait faire, c'était «Dock of the bay». point final de l'oeuvre avant la
mort de l'artiste, mais sans doute aussi point de départ vers autre chose que
la cire ne recueillera jamais. Quoi ? Le morceau est notre seule indication.
Pour moi de loin inférieur à «Tenderness», Il semble bien être le signe d'un
rapprochement avec la pop music telle qu'on la pratique à Londres,
c'est‑à‑dire essentiellement «technique» (recherche de sonorités, de
couleurs, d'harmonies au détriment de l'esprit). Apparemment fasciné par les
groupes anglais, Otis était‑il en train de tenter le miracle consistant à
synthétiser l'intellectualisme de leur musique avec la vitalité débordante de
la sienne? Allait‑il réussir ? Ce sera pour les
exégètes de la pop music, le grand mystère d'Otis Redding.
Il est mort
sans avoir tout dit, cela nous autorise à supposer qu'il avait encore mieux à
dire et aussi à le regretter un peu plus.
PHILIPPE PARINGAUX
retour à la page "LA PRESSE"